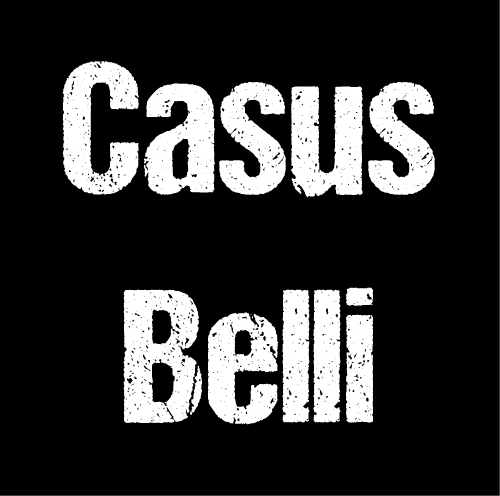« La détermination des magistrats et des enquêteurs sera à la hauteur de ce déchaînement de violence »
« Tu paieras œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. »
Exode, XXI, 22.
Quand toutes les belles âmes émotionnées par l’attaque du fourgon pénitentiaire à Incarville seront passées à autre chose, c’est-à-dire demain matin, il sera peut-être temps de réfléchir enfin collectivement à la nature du fait carcéral, à ses conséquences psychosociales et, partant, à sa légitimité.
Qui n’a jamais mis les pieds dans un centre de détention ou une maison d’arrêt ne saurait avoir la moindre idée de ce que pourrait être la seule définition recevable de la prison, à savoir : une fabrique préméditée de détresse psychique, de promiscuité et de crasse avilissantes, menant mécaniquement soit à une extinction de l’âme, une éradication de tout élan vital, soit à une sauvagerie vindicative plus ou moins étouffée, et dont personne n’est capable de prévoir si – ni quand – elle finira par entrer en éruption.
Avec 76.766 détenus au 1er mars, la surpopulation carcérale a atteint un niveau sans précédent en France, selon des chiffres publiés ce vendredi par le ministère de la Justice. En tout, 3.099 détenus sont contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol de leur cellule. La densité carcérale globale s’établit désormais à 124,6%.
Dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines, elle atteint même 148,7%. Dans 12 établissements ou quartiers, elle atteint ou dépasse les 200%.
Face à cette surpopulation carcérale chronique, le Conseil de l’Europe a exprimé à la mi-mars sa "profonde préoccupation". En juillet dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait condamné la France pour ses conditions "indignes" de détention. Preuve que le problème est ancien, la CEDH avait déjà épinglé Paris en 2020 pour la surpopulation de ses prisons.
(Radio France, 29 mars 2024)
Ces « conditions indignes » conjoncturelles, qui auraient dû depuis longtemps soulever à elles seules la foule des habitués de l’indignation citoyenne, ne font qu’aggraver une pratique d’enfermement non seulement abjecte par essence, mais intégralement inutile et contreproductive. Quelles que soient les diverses « fonctions » qu’on prétend lui assigner, rien de bon ni de profitable pour quiconque ne sortira jamais d’un dispositif anthropophage comme celui de la prison.
Il se trouve qu’en dehors de mes activités d’animateur d’ateliers philosophiques « en milieu pénitentiaire », j’ai eu l’occasion de faire l’expérience, pendant le mouvement des Gilets jaunes, de l’incarcération dans les geôles de la République – une trentaine d’heures seulement… Eh bien, je dois confesser que lorsqu’un homme ferme une porte sur vous, quelque chose se brise de cette réciprocité ontologique étrange qui existe ordinairement entre deux inconnus appartenant à une même espèce ; et si l’on m’avait dit à cet instant que ma liberté était au prix d’en finir brutalement avec ce maître des clés – jeune papa ou non –, je n’aurais peut-être pas hésité très longtemps.
Cédric Cagnat